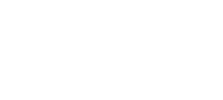L’industrie de la pêche au crabe des neiges a fait des pas de géants sur le plan technologique pour protéger les baleines noires menacées de disparition. C’est ce qu’affirme Robert Haché ex-directeur général de l’Association des crabiers acadiens (ACA), qui agit aujourd’hui en tant que consultant pour le projet Crabiers pour les Baleines initié en 2018 pour atténuer les interactions entre la flottille de pêche de la zone 12 du sud du golfe du Saint-Laurent et ces mammifères.
On se rappellera que la mortalité sans précédent de 17 baleines noires enregistrée l’année précédente, avait déclenché tout un train de mesures, tant au Canada qu’aux États-Unis, pour les protéger contre les empêtrements dans les cordages de pêche et les collisions avec les navires. Dans le cadre de son programme de recherche financé par le Fonds des pêches de l’Atlantique et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’ACA expérimente notamment les casiers avec cordage sur demande qui réduisent les risques d’accroc et qui permettent à ses utilisateurs de continuer à pêcher dans les zones fermées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) lorsque la présence d’une baleine noire est signalée.
«Au départ, absolument personne ne pensait utiliser des casiers sans cordage, c’est-à-dire des casiers qui sont sur le fond de l’eau mais qui ne sont pas reliés par une corde verticale à une bouée en surface; on pensait que c’était quelque chose d’absolument irréalisable, relate Robert Haché, Six ans plus tard, on a fait des pas de géants à ce niveau-là. Sur le plan technologique, mais surtout sur le plan de l’acceptation des pêcheurs de ce nouvel outil-là.»
Au fil des ans, le nombre de crabiers traditionnels du Nouveau-Brunswick à s’être dotés de casiers sur demande a progressivement augmenté pour s’établir à 31, en 2023. Chacun en a 50 casiers à sa disposition, précise M. Haché. C’est l’équivalent du tiers du maximum de cage autorisé par bateau. Cependant, la dizaine de pêcheurs à avoir investi les milliers de dollars nécessaires pour s’en équiper et bénéficier de subventions, il y a deux ans, n’ont pas encore pu les essayer en situation de pêche commerciale. Le consultant de l’ACA explique que c’est parce que les quotas ont été capturés avant même l’arrivée des baleines dans le sud du Golfe et ce, tant en 2023 qu’en 2024.
«Comme la pêche s’est déroulée très rapidement et que les baleines ont tardé à arriver, il n’y avait pas de zones fermées, dit-il. En 2024, par exemple, on a eu une diminution de quota de 30 % et des prises par unité d’effort inhabituelles, ce qui a fait en sorte que la plupart des pêcheurs avaient fini leur saison avant le mois de juin, moment où les baleines arrivent.»
Travaux 2025
L’ACA entend d’ailleurs reprendre, ce printemps, ses expériences prévues ces deux dernières années, afin de continuer à documenter la performance des casiers sur demande, avec lesquels cordages et bouées sont renfermées au fond de l’eau et qui remontent à la surface suite à l’envoi d’un signal acoustique. «Pour l’essentiel, les pêcheurs du Nouveau-Brunswick reconnaissent que ces engins sont devenus un outil presqu’essentiel pour eux, si les baleines continuent à être présentes dans le sud du golfe du Saint-Laurent en aussi grand nombre qu’on a vu ces dernières années. Parce qu’elles entraînent un nombre extrêmement important de fermetures de zones de pêche», affirme Robert Haché.
En fait, depuis que les baleines noires de l’Atlantique ont commencé à fréquenter le Golfe pour se nourrir il y a une dizaine d’années, au moins 50 % de la population estimée à 372 individus y circule du printemps jusqu’à la fin de l’automne. Et lorsque le MPO en observe une visuellement, il ferme le secteur pour deux semaines consécutives, De plus, s’il y fait une seconde observation au cours de cette période, il ferme carrément la zone pour toute la durée de la saison.
Pour s’adapter à cette réalité, le Regroupement des pêcheurs professionnels des Îles-de-la-Madeleine (RPPÎM) s’apprête lui aussi à tester des casiers à remontée sur demande, cette année. Après 18 mois d’attente, l’été dernier, il a finalement obtenu à cette fin une subvention de 161 000 $ du Fonds des pêches du Québec. L’octroi couvrira 90 % des coûts d’acquisition d’une vingtaine d’engins développés par la firme TH MR de New Carlisle. Le représentant du RPPÎM, Paul Boudreau, raconte que cette technologie a la particularité d’être dotée d’un enrouleur de cordage automatique. «Ça devrait permettre de sauver du temps de travail sur le pont, explique-t-il. Avec la technologie Edge Tech [développée aux États-Unis] qu’expérimente l’ACA, le processus de rembobinage se fait plutôt à la main.»
Encore des faiblesses
Cela dit, M. Boudreau ne se berce pas d’illusions sur l’efficacité des casiers avec cordage sur demande, peu importe leur fabriquant. Il y en a quatre sur le marché présentement, soit l’américaine Edge Tech et la gaspésienne TH MR, de même que Devocean de Rimouski et Ashored, de Bedford en Nouvelle-Écosse. Or la technologie pour déclencher à distance la remontée à la surface des bouées auxquelles sont rattachées les casiers est si dispendieuse – on parle de 8 000 $ à 10 000 $ par bouée – que les pêcheurs sont contraints de travailler avec des lignées d’une dizaine de cages pour économiser, plutôt qu’avec des casiers individuels. «Un trawl de cages à crabe c’est difficile à pêcher parce que quand tu tires sur la première, les autres se trainent sur le fond de pêche. Elles ne montent pas toutes par en haut en même temps. Et ça, c’est la grande faiblesse : les casiers se remplissent de terre, de sable, de bouette», expose le porte-parole des crabiers traditionnels madelinots.
Même son de cloche du côté de l’Association des crabiers gaspésiens (ACG), dont le président Daniel Desbois, capitaine de L’ANSE À LA BARBE, a à ce jour expérimenté les systèmes Edge Tech et Ashored. «On n’a pas eu de bons résultats avec Edge Tech, parce que le réseau de communication sans fil ne fonctionnait pas quand on était en mer, signale-t-il. Et avec Ashored, les bouées prenaient l’eau, ça fait qu’elles restaient entre deux eaux plutôt que de remonter à la surface. Ce n’est vraiment pas une technologie qui est à point. C’est important pour nous que ça fonctionne à tout coup, ce qui n’a vraiment pas été le cas à date.»
L’absence de contact visuel avec les bouées des engins de pêche, comme point de repère à la surface de l’eau, est aussi une contrainte majeure des casiers sur demande, souligne M. Desbois. «S’il vente à plus de 20 nœuds, la houle t’empêche de voir où la bouée va sortir, indique-t-il. Et en plus, quand il vente trop, tu risques de casser tes cordages plus souvent parce que les lignées de cages sont beaucoup plus lourdes. Alors ça augmente les risques de casiers fantômes. Et c’est sans parler du fait que plus ton trawl est long, plus tu risques de le jeter par-dessus celui d’un autre, ou encore d’avoir un rendement insuffisant parce que t’as des cages qui sont tombées sur la roche où y’a rien.»
Malgré tout, l’ACG souhaite étendre ses essais aux équipements de TH MR et Devocean, le printemps prochain. Ces deux technologies opèrent avec un enrouleur automatique de cordage. Notons également que l’usage des casiers sur demande n’est pas exclusif à une flottille en particulier. Tout pêcheur intéressé à les utiliser doit néanmoins obtenir au préalable un permis scientifique de la part du MPO.
TECHNOLOGIES – page 29 – Volume 38,1 Février-Mars-Avril 2025