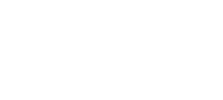La crevette nordique poursuit son déclin. Les récents stocks suivent les mêmes tendances à la baisse que ceux observés au cours des dernières années. «Dans Sept-Îles, Anticosti et Esquiman, ce sont les plus faibles valeurs de la série qui a débuté en 1990», va jusqu’à dire Hugo Bourdages de Pêches et Océans Canada.
Par conséquent, la situation de 2024 n’a pas changé significativement par rapport à celle de 2023 : la crevette se trouve dans les plus faibles valeurs de biomasse estimées.
Les stocks de Sept-Îles, Anticosti et Esquiman font face à des conditions environnementales difficiles qui peuvent même affecter leur survie. «La température est toujours chaude, confirme le biologiste de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli. Le niveau d’oxygène a diminué. Il est encore à des niveaux très faibles. Puis la prédation par le sébaste est toujours historiquement élevée.» Dans son approche de précaution, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) évalue ces secteurs de pêche comme étant en zone critique.
Situation différente dans Estuaire
La zone Estuaire est différente des trois autres, de l’avis de M. Bourdages : elle est dans la zone saine. «En août 2024, on a fait notre relevé scientifique. Dans Estuaire, on échantillonne de la même manière depuis 2008 et ce sont les plus fortes valeurs de biomasse que l’on observe.»
Cependant, comme cette zone est plus difficile à échantillonner que les autres parce qu’elle est petite et étroite, il y a davantage de variabilité dans l’estimation de la biomasse. «On a beaucoup plus d’incertitude dans nos estimations, souligne le biologiste. On demeure prudent dans l’avis que l’on donne pour Estuaire.»
Le stock dans Estuaire a aussi fait face au réchauffement des eaux profondes et à la perte d’oxygène. «Mais depuis 2018, la distribution des crevettes a changé, soulève l’expert. Au lieu de retrouver des crevettes entre 150 et 350 mètres de profondeur, on les retrouve entre 125 et 200 mètres.» Une autre différence repose aussi, selon Hugo Bourdages, sur la moins grande abondance du sébaste.
Recrutement et distribution
Le recrutement est aussi très faible depuis les cinq dernières années. «Ça nous amène à penser que l’abondance de la crevette ne s’améliorera pas à court terme», avance M. Bourdages.
Les changements dans l’environnement du petit crustacé affectent aussi sa distribution. «Les crevettes sont absentes de la partie la plus profonde de la distribution, soit celle de 250 à 300 mètres, parce que l’eau est trop chaude. Mais, lorsque l’on revient plus près de la côte, soit à des profondeurs de 150 ou 200 mètres, c’est là qu’on les retrouve. Son habitat, soit la superficie où l’on rencontre la plus forte concentration de crevettes dans le golfe du Saint-Laurent, a diminué de 50 % dans les dernières années.»
Stabilisation des facteurs négatifs
Si l’eau s’est réchauffée dans les dernières années pour atteindre des températures record en 2022, les scientifiques ont néanmoins observé une stabilisation de la température depuis deux ans. «Le réchauffement s’est arrêté pour un moment, constate Hugo Bourdages. En 2024, on est encore dans des températures qui sont chaudes, mais elles sont inférieures aux températures observées en 2022.»
La prédation par le sébaste est un autre facteur déterminant ayant eu un impact sur la diminution des stocks de crevettes. La population de sébastes a augmenté significativement au cours des dernières années pour devenir très abondante. «Mais, cette population est présentement en diminution, nuance le spécialiste de la crevette nordique. Il n’en demeure pas moins que la population de sébaste est toujours historiquement élevée.»
Les facteurs négatifs pour la perle rose du Saint-Laurent se sont donc stabilisés. «Mais, on ne peut pas dire que la situation est belle pour la crevette, tempère M. Bourdages. On est encore au cœur de la tempête. Les conditions sont encore extrêmes.»
Adaptation de la crevette
Face à des conditions de réchauffement et de perte d’oxygène, la crevette n’a d’autre choix que de s’adapter. «Quand une espèce fait face à des conditions qui ne lui sont pas favorables, elle se déplace, explique le chercheur du MPO. C’est ce qu’on voit chez la crevette nordique, mais à l’échelle locale, dans les zones de pêche. On ne parle pas de déplacement à l’extérieur du golfe.»
Sa manière de s’adapter se reflète également dans son cycle de reproduction. «Les femelles vont devenir plus matures pendant l’été, elles vont pondre les œufs à l’automne pour qu’ils se développent tout l’hiver jusqu’à leur éclosion au printemps, observe Hugo Bourdages. Vu que l’eau est plus chaude, les œufs ont besoin de moins de temps pour se développer. Au cours des dernières années, on a vu les crevettes pondre de plus en plus tard dans la saison.»
Cependant, le biologiste a agréablement été surpris d’apprendre, lors de la dernière évaluation, qu’un pêcheur avait observé que les crevettes avaient recommencé à pondre au même moment que d’habitude dans la zone Sept-Îles. «J’étais content de savoir ça parce que j’avais observé, dans le relevé de la zone Estuaire, que les crevettes s’étaient déplacées près de la couche intermédiaire froide pour retrouver des températures qui lui sont plus favorables. Puis dans Sept-Îles, c’était la première fois qu’on voyait des crevettes se déplacer pour se rapprocher de la zone intermédiaire froide et pondre à des dates normales.»
Totaux autorisés de capture
«On avait revu l’approche de précaution à l’automne 2023 pour déterminer les TAC pour la saison de pêche 2024, ce qui avait apporté des diminutions très significatives, mentionne M. Bourdages. Dans les dernières années, les taux d’exploitation des stocks étaient en augmentation. Donc la quantité de crevettes prélevée par rapport à la quantité estimée était de plus en plus importante. Avec la nouvelle approche de précaution, ces taux d’exploitation ont été faibles dans les quatre stocks du golfe du Saint-Laurent.»
Or le ministère a appliqué la même approche de précaution pour faire des projections de prélèvements pour la prochaine saison. «Dans l’approche de précaution, on utilise quatre règles de contrôle des prises, qui dépendent de l’état du stock, explique Hugo Bourdages. Dans Estuaire, étant donné que le stock est dans la zone saine, les prélèvements projetés sont de 1 425 tonnes.
Comme les trois autres zones sont jugées critiques, les TAC seront plus faibles. Dans Sept-Îles, qui est le stock le plus creux de la zone critique, le TAC pourrait varier de 0 à 807 tonnes. Dans Anticosti, il se situera entre 0 et 885 tonnes. «Ce sont donc des débarquements qui pourraient doubler par rapport à 2024, croit le spécialiste. Mais ça demeure des débarquements faibles comparativement à ce qu’on a déjà connu dans ces zones.» Le TAC dans Esquiman pourrait être de 0 à 1 171 tonnes.
Il reviendra à la ministre fédérale des Pêches Diane Lebouthillier d’annoncer les TAC d’ici le début de la prochaine saison de pêche, soit avant le 1er avril.
BIOLOGIE – page 12 – Volume 38,1 Février-Mars-Avril 2025