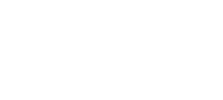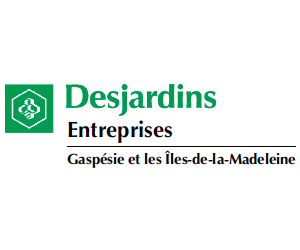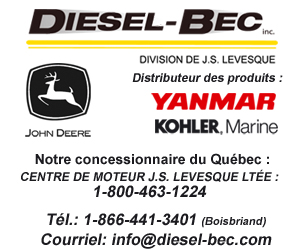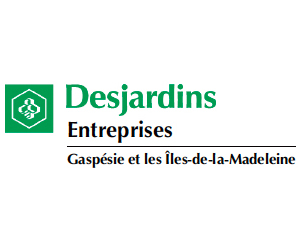Le stock de sébaste du golfe du Saint-Laurent poursuit son inexorable déclin. En réunion annuelle du Comité consultatif de gestion, les 1er et 2 avril, à Montréal, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a fait état d’un déclin de 23 % de la biomasse de poisson rouge des Unités 1 et 2 du golfe du Saint-Laurent, au cours de la dernière année. Selon la plus récente évaluation scientifique ministérielle, elle n’est plus que de 1,9 million de tonnes métriques ™ et ce, pour les deux espèces S. mentella et S. fasciatus combinées.
On se rappellera que la biologiste Caroline Senay, chargée du suivi du stock à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), avait conclu en janvier 2024, lors de la mise à jour de sa précédente évaluation complète, que la population de sébaste décroit en moyenne de 25 % par année et ce, même en l’absence de pêcherie (Pêche Impact, février 2024). « Ce n’est pas une bonne nouvelle [que ça se confirme à 23 %], reconnaît-elle. Mais c’est grosso modo ce qu’on avait prédit l’année dernière. Les pêcheurs ne sont vraiment pas à blâmer parce que c’est de la mortalité naturelle qu’on voit dans le système. »
La biomasse de sébaste est ainsi progressivement passée d’un sommet de 4,3 millions tm en 2019, à 3,3 millions tm en 2021, puis à 2,5 millions tm en 2023, avant de chuter sous la barre des deux millions l’an dernier. Selon Mme Senay, ce déclin par mortalité naturelle s’explique par l’incapacité de l’écosystème à supporter la trop forte densité de la population. « C’est la résultante d’un stock qui est plus abondant que la capacité de support du système, explique-t-elle. Il n’y a pas assez de nourriture pour que chacun de ces petits sébastes se nourrisse bien et ait la meilleure vie qu’il puisse avoir. »
Ainsi, bien que la biomasse ne soit plus que de 1,9 million tm et qu’aucune nouvelle cohorte d’importance n’ait été observée depuis 2013, la population totale est quand même de trois à quatre fois plus importante qu’elle ne l’a été avant le moratoire de 1995. À l’époque, au cours de la période 1984-1990, on enregistrait une biomasse moyenne de 762 000 tm. Aussi croit-on que ce soit en raison de la forte densité du stock que les poissons rouges issus des immenses cohortes de 2011, 2012 et 2013 ne grandissent pas aussi rapidement que ceux des générations antérieures.
L’augmentation de la température de l’eau du Golfe pourrait aussi être en cause, puisque des expériences en laboratoire ont récemment démontré que l’exposition à des températures supérieures à 5 ˚C entrainerait une baisse des taux de croissance. Même que les individus des Unités 1 et 2 atteignent désormais leur maturité sexuelle à une taille beaucoup plus petite, soit de 19 cm plutôt que 24 cm.
« Ça fait depuis 2021 que la taille modale, la taille la plus commune des sébastes, est à 24 cm, précise la biologiste de l’IML. Et là, cette année : youpi! On est arrivé à 25 cm. Mais on espérait mieux, il y a quelques années. Si ces poissons-là avaient suivi la croissance qu’on pensait qu’il allait y avoir, basée sur la grosse cohorte de 1980, ils auraient dû être à 30 cm. Ça grandit encore un peu, mais on a accumulé un bon retard. »
Travaux de recherche
Cela dit, au rythme où le stock de sébaste décline, quand est-ce qu’il y aura assez d’espace dans l’écosystème pour qu’il puisse évoluer à son aise? « C’est possible que la mortalité naturelle finisse par ralentir, mais malheureusement, il n’y a personne qui sait à quel niveau ça va se stabiliser, ni si ça va effectivement se stabiliser, nous répond Caroline Senay. Il faut savoir que l’écosystème est en changement. La crevette, le plancton, les autres espèces de poisson que mange le sébaste : tout ça est en changement en ce moment. Et donc, de savoir où est le nouvel équilibre, c’est quelque chose qu’on ne peut pas prédire. »
L’IML entreprendra néanmoins de nouvelles recherches en bassin pour vérifier si la faible croissance des poissons rouges peut s’inverser dans un écosystème à plus faible densité populationnelle. Sur une période de deux ans, on procédera d’abord à simuler les facteurs de densité/dépendance pour évaluer l’impact d’un faible apport de nourriture sur leur croissance. On pourra, par la suite, mesurer leur réaction à une réintroduction progressive d’une nourriture plus abondante.
« Si on diminue la quantité de nourriture disponible pendant un certain temps et que la croissance diminue, bien, après, si on leur redonne de la nourriture en abondance, vont-ils reprendre une croissance normale ou cette croissance est arrêtée pour toujours? Il faudra attendre au moins deux ans pour répondre à cette question, pour avoir des résultats préliminaires qui ressemblent vraiment à ce qui se passe dans la nature, parce que juste pour arrêter la croissance, il faudra qu’on les laisse avec des rations faibles pendant presque un an », expose Caroline Senay, qui indique n’avoir obtenu le feu vert d’un fonds de recherche du MPO pour ce « projet spécial » qu’en date du vendredi 11 avril.
Analyses génétiques
D’autre part, la biologiste nous apprend que l’lML entreprendra une analyse génétique des captures commerciales de sébaste 2025, afin de mieux guider les mesures de gestion visant à éviter la capture de l’espèce S. fasciatus, dont l’abondance ne compte que pour environ un dixième de la biomasse totale du stock. Elle rappelle que c’est pour diriger les activités de chalutage vers le S. mentella nettement plus abondant et pour éviter les prises accessoires que le MPO avait adopté les diverses limites saisonnières de profondeur qui ont tant fait rager les pêcheurs l’an dernier (Pêche Impact, septembre 2024).
« Soixante mille tonnes de quota versus une biomasse de 1,9 million, ça va pour S. mentella, mais avec une biomasse de 190 000 tm de S. fasciatus, il faut vraiment y faire attention, souligne Caroline Senay. En ce moment, on n’en connaît toutefois pas l’importance dans les captures totales de 3 000 tm enregistrées en 2024-2025. Ce qu’on sait, c’est que S. mentella se situe à de plus grandes profondeurs. Et donc au début de la saison, en vertu du plan de pêche mis en place pour l’été, les pêcheurs devaient aller à plus de 300 m, des endroits où il n’y a presque pas de S. fasciatus. Je comprends que c’était fatiguant pour les pêcheurs : il faut aller plus loin, c’est plus dangereux, ça coûte plus cher de gaz. Et au mois d’octobre dernier, le gouvernement a pris un pas en arrière et a changé la limite à 240 m. Mais on ne sait toujours pas ce qui est sorti de l’eau. »
Pour tenter de répondre à cette question, la biologiste a ciblé les pêcheurs ayant été les plus actifs depuis la levée du moratoire, tant au Québec qu’à Terre-Neuve et ailleurs dans les Maritimes. Chacun recevra une trousse de tiges de coton pour échantillonner les cellules muqueuses des joues de sébaste, aux fins de séquençage génétique en laboratoire. Mme Senay parle d’un projet pilote pour lequel elle vise un échantillonnage de 6 000 poissons.
« On commence doucement, dit-elle. Si c’est une petite saison comme celle de l’an dernier, on devrait couvrir une bonne partie des voyages de pêche. Restera à voir comment ça se travaille à bord, c’est quoi la réception des équipages. Et pour nous, ce sera la première année qu’on en passe autant au laboratoire; on verra combien de temps ça nous prend pour rendre nos préparations et toutes nos étapes le plus efficaces possible et à un prix raisonnable. »
Gestion 2026-2027
Pour sa part, le gestionnaire de Madelipêche, Paul Boudreau, ne s’inquiète pas outre mesure du considérable déclin du stock de poisson rouge du golfe du Saint-Laurent par mortalité naturelle. Il note que, malgré tout, les scientifiques du MPO sont d’avis qu’il pourrait supporter un quota de pêche commerciale de 253 000 tm de S. mentella dans l’Unité 1, soit de quatre fois supérieur à celui établi l’an dernier. « La recommandation des sciences est largement supérieure à la capacité de capture et de transformation de l’industrie. Et tant qu’il n’y aura pas de marché, ce ne sera pas une pêcherie intéressante; ce ne sera pas une pêcherie rentable », laisse-t-il tomber.
L’an dernier, sur un quota d’entreprise de 20,8 millions de livres, Madelipêche n’en a livré à quai que 300 000 livres. Seul le capitaine du Jean Mathieu, Denis Éloquin, a participé à cet effort de pêche. En comparaison, son confrère Yan Bourdages de Rivière-au-Renard, capitaine du Meridian 66, a capturé près de 700 000 livres de sébaste, dont 210 000 livres en cours d’hiver.
Pour la saison 2025-2026, on s’attend à ce que le plan de gestion soit annoncé d’ici la mi-mai, de sorte à ce que la pêcherie débute le 15 juin, tout comme l’an dernier. En ce qui concerne les profondeurs de chalutage, l’industrie de la capture croit que le MPO maintiendra à 240 m la limite pour la pêche d’été, qui s’étend jusqu’au 31 décembre dans les zones 4RST et 3Pn 4Vn. « Les changements de profondeurs apportés l’automne dernier étaient satisfaisants », convient M. Boudreau.
Madelipêche anticipe aussi le statu quo, à 183 m, pour la limite de profondeur autorisée pour la pêche d’hiver, qui se pratique au chalut pélagique du 1er janvier au 31 mars. Cependant, les entreprises de pêche réclament aussi l’autorisation de pêcher dans les divisions 4RS du nord du Golfe pendant l’hiver, comme le voulait la tradition avant le moratoire de 1995. À la consternation générale, ces zones ont été fermées en début d’année, alors que la pêcherie n’a été permise que dans les secteurs 3Pn 4Vn à l’extérieur du Golfe, ces derniers mois. « Ça n’a pas de bon sens!, lâche Paul Boudreau. L’hiver, la pêche d’hiver a toujours inclus 4RS et 3Pn 4Vn et là, on a retiré la pêche dans le Golfe, sans aucune justification. Dans le fond, on a eu peur d’avoir peur et on a mis trop de restrictions au niveau de la pêche. Il faut que le MPO assouplisse ses mesures de gestion », conclut-il.